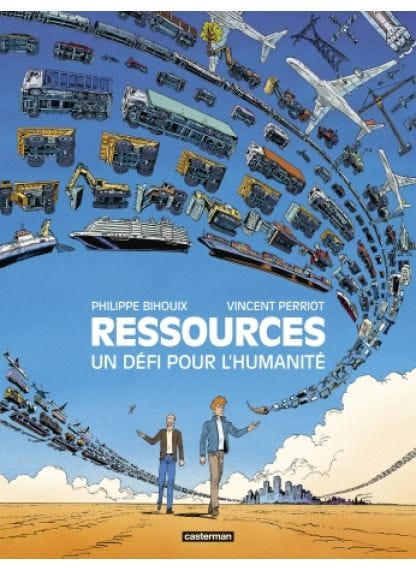Exfiltré(e)s - Hiver 2025 - Captage Carbone : est-ce qu’on se fait enfumer ?
Tu es francophone ? Ce post est pour toi. International readers : switch to the English section of this blog : https://exfiltrees.substack.com/s/extracted
Quel est le point commun entre ce concours (100 millions USD à la clé 💵!) lancé par la Fondation X d’Elon Musk, cette annonce de la banque JP Morgan, cet autre communiqué du département de l’énergie américain ? La réponse tient en 3 lettres : CCS (Carbon Capture Storage).
Depuis quelques années, vous n’avez pas pu échapper aux gros titres et à l’emballement suscité par les technologies (plus ou moins matures) du captage de carbone. Bien avant l’élection de Donald Trump, des projets aux tonalités messianiques surgissent de toute part : ici on parle de « Frontier » : (une initiative lancée par Stripe, Alphabet, Meta, Shopify et McKinsey en 2022), ailleurs c’est le projet « Deep Sky », une start-up canadienne de captage direct du carbone dans l'air, qui reçoit 40 millions de dollars d’un fonds de Bill Gates en 2024.
Avec l’accélération très significative des subventions accordées, entre autres, dans le cadre de l’Inflation Reduction Act aux Etats-Unis et du programme “Fit for 55 package” en Europe, les investissements publics et privés dans les technologies CCS ont triplé en deux ans pour atteindre plus de 6 milliards en 2023 selon Bloomberg ; Et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Pourtant les résultats ne sont pas (encore?) complètement au rendez-vous, comme le note le FT : “Peu de technologies ont reçu autant d'investissements pendant autant d'années de la part de tant de gouvernements et d'entreprises, avec des résultats si peu convaincants”.
Alors, solution miracle ou fantasme rocambolesque et dangereux ? Comment décoder l’engouement monumental pour le CCS? Ce sont les questions que nous abordons dans ce numéro.
Bonne lecture et merci à nos nouveaux abonnés ! N’hésitez pas à partager ce numéro, ou à nous faire part de vos commentaires, remarques et suggestions.
GRAND ANGLE 💡
CCS ? Quèsaco ?
Les techniques de captage et séquestration du carbone1, regroupent plusieurs méthodes. Bien que certaines de ces technologies existent depuis plusieurs décennies, leur utilisation a été limitée, notamment à cause de leur consommation élevée en énergie et en eau, ainsi que des coûts de développement élevés. Mais récemment de nouveaux facteurs tels que la taxe carbone en Europe où les subventions publiques massives aux Etats-Unis, ont relancé le marché. Parmi les technologies CCS, on trouve:
La postcombustion : Cette méthode, la plus mature actuellement, consiste à capter le CO₂ après la combustion des combustibles fossiles. Les fumées des usines sont mélangées à un solvant qui absorbe le gaz avant de le transférer dans une tour de régénération pour le chauffer à très haute température (process énergivore) ce qui permet d'extraire le CO₂.
La précombustion : Ici, le CO₂ est extrait avant la combustion. Cette technique nécessite une modification des infrastructures des usines en amont et elle n’est que très peu utilisée car il y a peu d'applications possibles. Ce procédé a néanmoins l’avantage d’être moins énergivore et permet d'obtenir de l'hydrogène, qui peut être utilisé comme source d'énergie.
L’oxycombustion : Cette méthode utilise de l'oxygène pendant la combustion des énergies fossiles, produisant ainsi une fumée très concentrée en CO₂, ce qui facilite sa capture.
La “Direct Air Capture” (DAC) : A la différence des autres technologies, il s’agit ici de capter le carbone directement dans l’air. Les installations peuvent donc être totalement décorrélées des sites de production. Le DAC pose des contraintes techniques supplémentaires à cause de la faible concentration de CO₂ dans l’air.
Transport et stockage
Une fois capté, le CO₂ doit être condensé et transporté, soit par pipeline, soit par bateau, soit encore par camion pour de petites quantités. Le CO₂ extrait est ensuite stocké dans des formations géologiques profondes, souvent sous la mer (“offshore”), notamment car les populations locales refusent le stockage à proximité de leur lieu de vie2. La mise en place de cette infrastructure et des sites de séquestration géologique est coûteuse, chronophage et avec un impact environnemental significatif (eau, forage etc).
Des technologies alternatives pour remédier au problème du stockage géologique sont en cours de développement. On citera par exemple la start-up icelandaise Carb Fix.
Ça ressemble à quoi en vrai ? Quelques exemples de grandes installations
Le plus grand “aspirateur à CO₂” (technologie DAC) du monde se situe à Mammoth (Islande) : Développé par la start-up suisse Climeworks, ce site, basé sur un volcan dormant a été inauguré en 2024 et peut capter 36 000 tonnes de CO₂ par an (équivalent des émissions de CO₂ générées par environ 4 000 foyers en France sur une année). La centrale utilise des ventilateurs géants pour aspirer l'air et capturer le CO₂, qui est ensuite stocké sous terre dans des roches basaltiques à un kilomètre de profondeur. Pour mieux comprendre le fonctionnement, nous vous conseillons ce court reportage de la BBC Inside the Icelandic plant turning CO₂ into rocks.
Bantam (Oklahoma). Aux Etats-Unis, le plus grand site de capture de carbone a aussi été inauguré pendant l’été 2024. Conçue pour capturer plus de 5 000 tonnes de CO₂ par an, la technologie élimine le CO₂ de l'atmosphère en chauffant du calcaire extrait d’une carrière, qui libère de l'oxyde de calcium. Cet oxyde de calcium est ensuite exposé à l'air, où il agit comme un absorbant pour capturer le CO₂. Le carbone capturé est ensuite réutilisé dans le processus d’extraction du pétrole. D’autres états pétroliers, comme le Texas et la Louisiane développent des méga-projets de captage, soutenus par des millions de dollars d’investissement.
En France on trouve quelques sites existants ou en développement financés par des industriels. On citera Arcelormittal, qui expérimente le captage de CO₂ sur son site de Dunkerque depuis 2022, ou Vicat qui prévoit de capter 1 million de tonnes de CO2 par an sur son site de Montalieu-Vercieu, la plus grande cimenterie de France.
(Crédit Vicat et les Echos. Le dispositif de capture et stockage du CO₂ envisagé par Vicat sur sa cimenterie de Montalieu-Vercieu prévoit de le transporter soit par barges, en profitant de l'accès au Rhône, par train, voire pipeline, afin de l'acheminer à Fos-sur-Mer).
Pour résumer : malgré les investissements faramineux, les installations en place demeurent relativement peu nombreuses, énergivores et expérimentales.
Cela semble peu engageant, mais dans quelle mesure le CCS est-il un passage obligé pour atteindre la neutralité carbone? Peut-il être rentable écologiquement et financièrement?
Un passage obligé pour arriver à la neutralité carbone en 2050 - mais à quelle hauteur ?
Dans sa feuille de route publiée en mai 2021, « Net Zero by 2050 », l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estimait que l’on devrait capter chaque année quatre milliards de tonnes de CO₂ d’ici 2035 puis 7,6 milliards d’ici 2050 (soit 20 % des émissions actuelles) pour respecter le scénario de neutralité carbone en 2050. Cela représenterait près de 10% de l’effort de réduction des émissions nécessaire.
Mais avec les 50 millions de tonnes (Mt) annuelles actuelles (moins de 1% des émissions), nous sommes bien loin de l’objectif : les capacités actuelles de CCS devraient être multipliées par un facteur supérieur à 100 ! Ainsi, d’après les derniers chiffres recueillis par l’AIE et malgré une croissance exponentielle, les projets actuellement annoncés porteraient les capacités globales annuelles de capture à 435 Mt d’ici 2030, et de 625 Mt pour le stockage. Cela ne représente que 40% (capture) et 60% (stockage) des chiffres à atteindre pour le scénario de neutralité carbone à 2050.
Capacités des projets actuels et planifiés de capture à grande échelle vs scénario net zero (Mt CO₂), 2020-2030
Quid de la viabilité financière et écologique ?
Face au défi du financement de ces projets, il est crucial de se poser la question de la rentabilité, à la fois financière et en termes d’effort de réduction des émissions. En effet, les investissements connaissent ces dernières années une croissance exponentielle, notamment aux Etats-Unis. On prévoit des taux de croissance de 15 à 20% par an dans la prochaine décennie, et une grande partie de ces investissements provient directement des financements publics, à grands coups de subventions et de crédits d’impôt :
Cependant, l’histoire du CCS est marquée par des coûts exponentiels, une forte fragilité des modèles de rentabilité due au prix fluctuant et trop bas de la tonne de carbone, et surtout par une incapacité à véritablement délivrer des résultats sur le plan industriel. Selon le cabinet Wood MacKenzie, 68 projets initiés ont été abandonnés faute de rentabilité - alors que 41 étaient en opération en 2023. Si certains tempèrent ces échecs en soulignant la nécessité d’investir pour améliorer les processus actuels, la technologie derrière la capture et le stockage n’est pas récente, et il y a déjà plusieurs décennies d’historique permettant de constater l’absence de rentabilité économique et les obstacles opérationnels.
Selon Bloomberg, pour les industries à forte intensité carbone (ammoniaque, ethanol, gas naturel), le coût de la capture par tonne se situerait entre 20 et 28 dollars, et il est plus élevé pour les industries telles que le ciment (79$) ou l’hydrogène et l’acier (72$). En ajoutant un coût de transport et de stockage entre 20 et 50$ par tonne (4 fois plus sous forme liquide), le coût total atteint les 92$-130$ soit 88€-125€- c’est bien au-dessus des prix actuels en Europe (entre 70 et 80€ la tonne), et très supérieur au prix des crédits carbones actuellement vendus en moyenne moins de 5€ la tonne. Pour les technologies de capture directe dans l’air, on se situe même au-delà des 1000 euros la tonne. Pour comparer, une tonne de carbone est capturée en moyenne par 40 arbres en croissance chaque année.
Le chiffre avancé par la MIT Technology Review est sans appel: même si nous parvenions à réduire le coût du CCS à 100 dollars la tonne, il faudrait 22 000 milliards de dollars d’investissements pour réduire le réchauffement de 0,1°C !
Se rajoute à ces obstacles la question de l’acceptabilité de ces projets par les populations locales, qui obligerait les projets à s’orienter vers les solutions les plus coûteuses comme le stockage off-shore. In fine, il est beaucoup plus efficace, même d’un point de vue strictement climatique, d’agir en amont sur la réduction des émissions, la préservation des puits naturels et dans les énergies renouvelables.
Des motivations plus sombres ?
Il est important de rappeler que les acteurs pétroliers, qui “capturent” aujourd’hui une part importante des subventions dans le domaine, utilisent cette technologie depuis longtemps, sans préoccupation environnementale. En effet, l’injection de CO₂ (sous-produit de la purification du méthane) dans les puits permet d’augmenter la quantité de pétrole extraite des gisements, dans ce cas le bilan global est négatif pour le climat. Cela représentait en 2021 entre ⅔ et ¾ du CO₂ capturé aux Etats-Unis. De plus, selon la réglementation I.R.S qui accorde la majorité des crédits d’impôts, ceux-ci ne seront pas remis en cause tant que le CO₂ capturé reste stocké au moins 3 ans (on est loin de 2050!).
Outre l'accaparement des subventions pour extraire plus de pétrole, le narratif des entreprises des secteurs très carbonés autour du CCUS (“U” pour utilisation) permet de légitimer une certaine continuité des explorations et l’augmentation des capacités, en arguant que l’innovation dans le domaine permettra in fine de capturer les gaz à effet de serre que l’on continue d’émettre. Les élus locaux dans les États américains concernés ne s’y trompent pas, militant pour le maintien des programmes de subventions (66 milliards sur 10 ans en crédits d’impôts) malgré le climato-scepticisme de Donald Trump.
En bref
La technologie de capture et stockage du carbone sera nécessaire pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à 2050. Cependant, elle fait face à des défis importants en matière d'échelle, de coût et d'acceptabilité sociale - il est plus rentable aujourd’hui d'investir dans la décarbonation au travers de la sobriété, des énergies renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique, et ce à la fois sur le plan financier et climatique. Une grande part des subventions allouées pour développer les technologies CC(U)S sont aujourd’hui allouées aux grands acteurs du fossiles sans véritable obligation de résultat à long-terme, au risque de retarder la décarbonation en justifiant la poursuite du “business-as-usual”.
Cet article vous a plu? Partagez-le en cliquant ici :
💚COUP DE CŒUR : “Ressources: un défi pour l’humanité” la BD que vous auriez aimé recevoir à Noël
Après “le Monde sans fin”, voici une nouvelle collaboration fructueuse entre un illustrateur (Vincent Perriot) et un ingénieur (Philippe Bihouix). Le plus? Nourrie des réflexions de Philippe Bihouix sur les ressources minérales et les technologies durables, la bande-dessinée nous offre une vision très globale et systémique des enjeux qui s’offrent à nous.
Riche de références à l’histoire de la pensée économique, elle décortique notamment les arguments des “cornucopiens”, ceux qui pensent que les ressources encore très abondantes de notre planète (et du système solaire!) pourront nous permettre de maintenir une croissance infinie. Et elle va bien au-delà, proposant aussi des solutions pour sortir du fantasme des milliardaires de la Silicon Valley.
On se délecte des magnifiques couleurs et créations futuristes de Vincent Perriot, qui endosse le rôle du Candide fasciné par les imaginaires de la science-fiction. Bref, un ouvrage à dévorer et à partager sans limite!
Ce numéro vous a plus? Abonnez vous en cliquant sur le lien ci-dessous :
Carbon Capture and Storage
Les sites potentiels les plus courants sont les aquifères salins, les gisements épuisés de pétrole et de gaz et les veines de charbon non exploitées.
Sources:
https://www.nytimes.com/2024/09/20/us/politics/carbon-capture-irs-subsidies.html
https://bonpote.com/capture-et-elimination-du-carbone-arnaque-ou-solution-pour-le-climat/